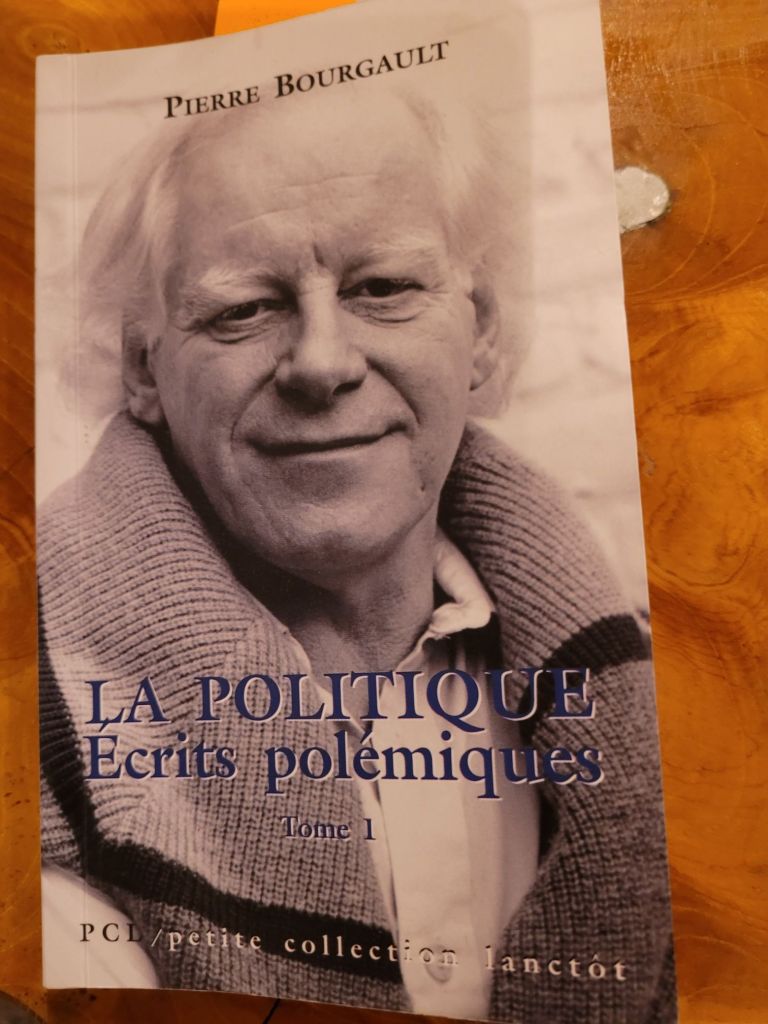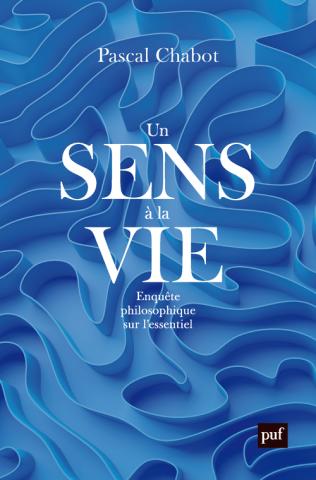Dans une phrase qui rappelle les réflexions du philosophe Alain de Botton dans « The architecture of happiness », Tura Cousins Wilson, le cofondateur de SOCA Architecture de Toronto, porte à notre attention l’importance de l’architecture dans des temps incertains :
In times of economic uncertainty, there’s often a fear that architecture will lose ambition – whether in sustainability, scale, size or materiality. But I believe the role of the architect is to be an optimistic pragmatist. We can always look for opportunities within constraints. Periods like this can lead to architecture that is more thoughtful and nuanced. Rather than being compromised by the challenges of the moment, architecture can act as a buffer against them. I work with many arts, cultural and non-profit organizations, and I hope my designs double down on helping them deliver their mandates. Those mandates – to uplift and enlighten – feel more necessary now than ever.
Traduit rapidement, ce texte exprime la chose suivante:
En période d’incertitude économique, on craint souvent que l’architecture perde de son ambition, que ce soit en matière de durabilité, d’échelle, de dimensions ou de matériaux. Mais je crois que le rôle de l’architecte est d’être un pragmatique optimiste. Nous pouvons toujours trouver des opportunités malgré les contraintes. Des périodes comme celle-ci peuvent donner naissance à une architecture plus réfléchie et nuancée. Plutôt que d’être compromise par les défis du moment, l’architecture peut servir de rempart. Je travaille avec de nombreuses organisations artistiques, culturelles et à but non lucratif, et j’espère que mes créations contribueront grandement à la réalisation de leurs missions. Ces missions – élever et éclairer – sont plus nécessaires que jamais.
Source: Globe & Mail, 17 janvier 2026.