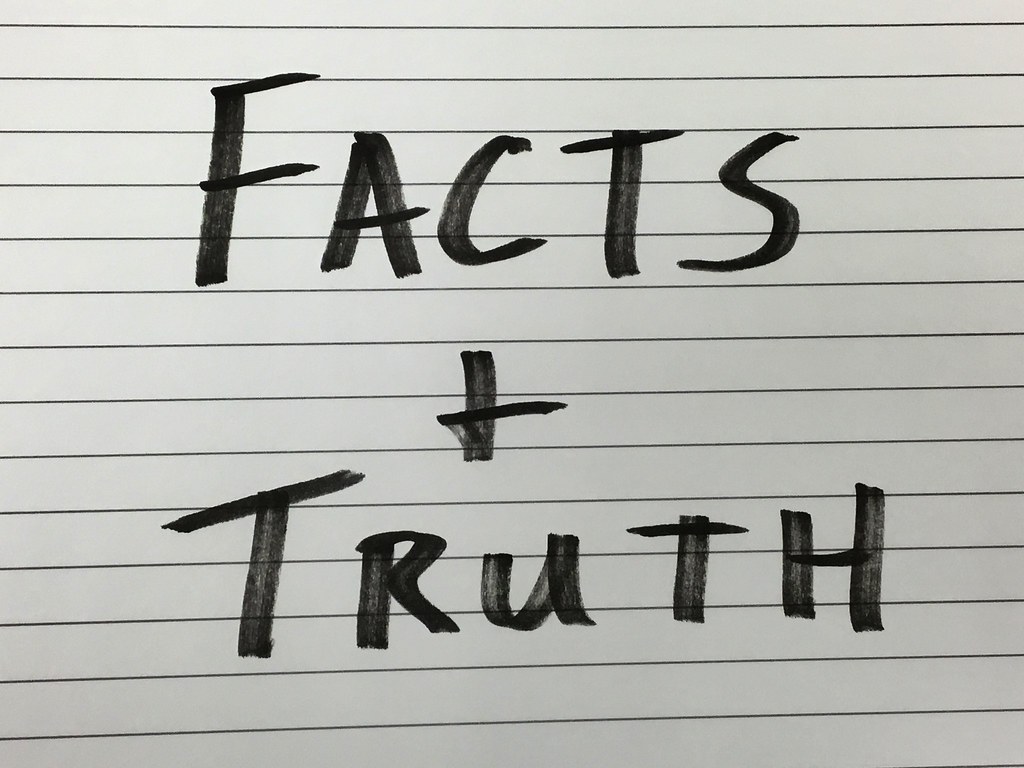Un article récent sur le site du Nieman Lab tente d’expliquer le fonctionnement des fausses nouvelles (les infox) par le biais de la neuroscience. Grosso modo, la nouveauté (ou la surprise), la façon dont notre processus mémoriel fonctionne ainsi que notre façon de décoder les émotions ont la plus grande influence sur nous. En voici donc quelques extraits pertinents :

licence CC BY-NC-SA 2.0
Sensory neuroscience has shown that only unexpected information can filter through to higher stages of processing. (…) Highly emotionally provocative information stands a stronger chance of lingering in our minds and being incorporated into long-term memory banks. (…) We rely on our ability to place information into an emotional frame of reference that combines facts with feelings. Our positive or negative feelings about people, things, and ideas arise much more rapidly than our conscious thoughts, long before we’re aware of them.
La conclusion est sans appel (ma traduction) : « La nouveauté et l’approche émotionnelle des fausses nouvelles, ainsi que la manière dont ces propriétés interagissent avec le cadre de nos mémoires, dépassent les capacités analytiques de notre cerveau. (…) En l’absence de tout point de vue faisant autorité sur la réalité, nous sommes condamnés à naviguer nos identités et nos convictions politiques au gré des fonctions les plus basiques de nos cerveaux. »
De plus, en 2017, les avertissements des spécialistes sur le caractère addictif de réseaux sociaux avaient fait les manchettes :
Ce que les chercheurs commencent à pouvoir affirmer, c’est que les réseaux sociaux ont un effet sur le cerveau proche de certaines substances addictives, comme la cigarette. Ofir Turel, professeur en systèmes d’information à l’université de Californie, a prouvé que « l’usage excessif de Facebook est associé à des changements dans le circuit de la récompense ». Car, contrairement à la télévision, les réseaux sociaux offrent des « récompenses variables » : l’utilisateur ne sait jamais combien de likes il va récolter ou sur quelles vidéos il va tomber.
Les recherches semblent donc indiquer que la façon dont les réseaux sociaux ont été construits permet d’abuser de certains mécanismes de nos cerveaux et il n’est donc pas surprenant que l’on voie donc des poursuites contre les grandes compagnies de cette industrie.